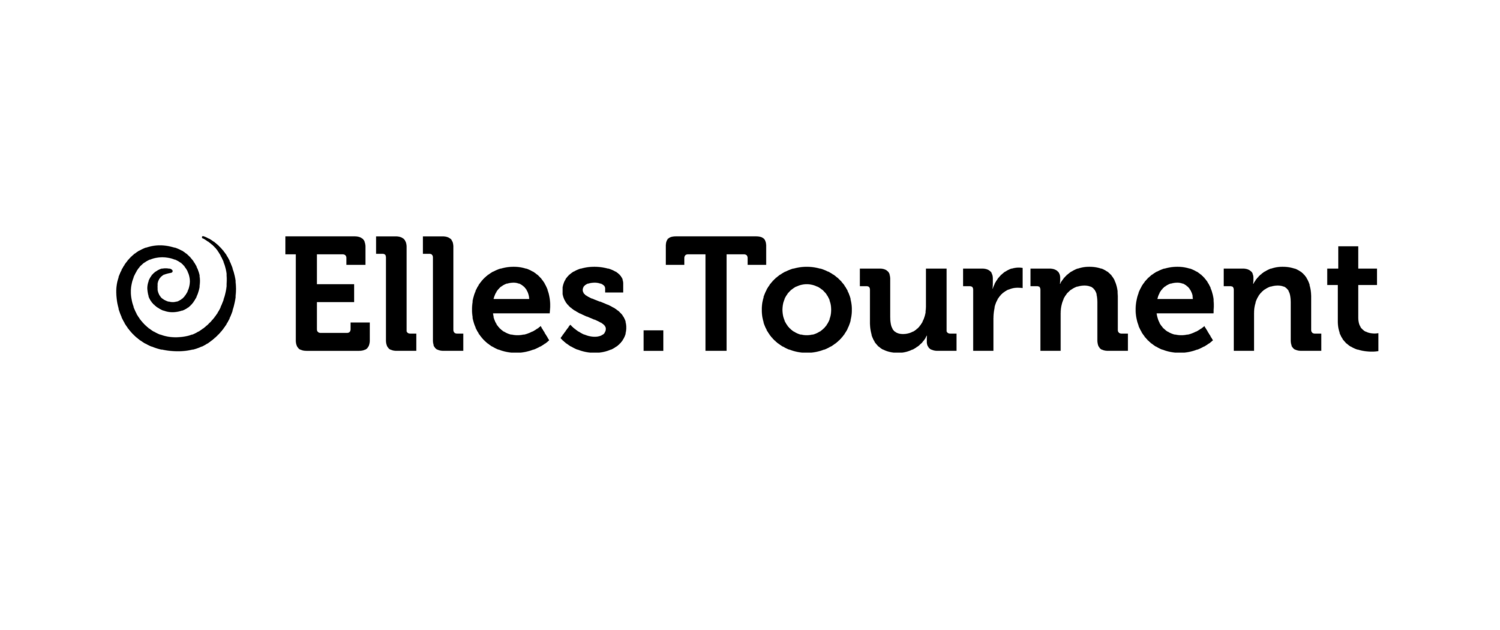Les chroniques d’Elisabeth
#2
Le loisir des loisirs de mon enfance, après la lecture, ce fut « la magie de la toile et de la salle obscure ». En ville, au Cinéac Nord, « on » ne passait que des films « enfants admis ». Mazette ! Tous les Charlie Chaplin, tous les Laurel et Hardy, l’alternance entre les images et ces jolis encadrés où figuraient ce qui s’y disait ou s’y faisait. Guère ou pas de femmes qui comptent. D’innocentes orphelines à protéger, la pauvre vendeuse de fleurs, aveugle, de « City lights », la ballerine paralysée de « Limelight », en somme… des faire valoir du héros.
Côté caméra, je regrette aujourd’hui de n’avoir pas vu à l’époque les réalisations d’Alice Blaché, mais j’ai appris le langage de l’image quand elle n’a quasiment pas besoin de mots, et les mille et une nuances de l’ombre et de la lumière qui donnent tant de relief au noir et blanc.
Le cinéma parlant ouvrait de nouvelles pistes. Pendant des années, les trois salles de mon quartier offraient un programme qui changeait à mi-semaine. Beaucoup de films d’Outre-Quiévrain (Marcel Carné », Eric von Stroheim, Marcel Pagnol , …).dont mon père, amoureux de « la » langue française, nous rinçait les oreilles avec les dialogues qu’il connaissait par coeur. Pas mal de clichés. , mais pour nous, ses enfants, un solide entraînement à l’écoute.
Et les femmes dans tout cela ? Maria Casarès, épouse fidèle, victime des amours scandaleuses de son Pierrot de mari, tombé dans les filets de Garance (Arletty), séductrice un peu garce (« Les enfants du Paradis »). Orane Demazis, qui s’est fait mettre enceinte par Pierre Fresnay (enfin, je veux dire « Fanny » et « Marius ») et dont l’honneur est racheté par le vieux quincailler qui l’épouse, magnanime. Il y avait eu « Angèle » (1934) aussi, innocente abusée, que le Fernandel un peu simplet conduira à l’autel. La jeune fille perverse qui tourmente un prêtre torturé (« Journal d’un curé de campagne » de Robert Bresson partant du roman de Georges Bernanos).
Il y a même eu, célébré par les Cahiers du cinéma, « La maman et la putain » (2h40), chef d’oeuvre de Jean Eustache… consacré à l’indécision amoureuse… d’un jeune monsieur, bien sûr.
Sous d’autres cieux, les femmes tourmentées d’Ingmar Bergman, (ses actrices préférées furent aussi ses épouses légitimes), la naïve Gelsomina (Giuletta Massina, dirigée par son mari Federico Fellini), donnée par sa mère à cette brute de Zampano (Anthony Quinn).
Je fais l’impasse sur le cinéma japonais, sauf sur « L’île nue » (Shindo – 1961) dont les protagonistes partagent à égalité une vie impitoyable ; pas de dialogue.
Presque pas de dialogue non plus, bien après, en 1975, dans « Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce ». Une cinéaste belge de 25 ans, Chantal Ackerman, y tire en longueur le quotidien d’une femme ordinaire comme on n’a jamais osé le faire, de façon presque documentaire.
Il y avait eu, en France, des réalisatrices telles qu ‘Agnès Varda (1955- « La pointe courte» ) qui, cette même année 1975, sortait un « Cléo de 5 à 7 », fiction-tranche de vie à la 1ère personne du singulierDe son côté, Coline Serreau réalisait un film choral « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? » ; sept femmes « normales » et singulières y parlaient de leur vie, tant l’ouvrière en usine textile de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing qui se levait à 3h30 du matin que la femme-pasteure de 72 ans, mère de 7 enfants, qui déclarait : « Je n’ai pas toujours fait ce que je voulais… mais je le ferai ! »
Au début des années ’70, le cinéma féministe entrait en scène. Massivement.